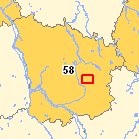Le pays de Maux et l'église Saint Michel |
La commune de Maux a une position originale
par rapport au Bazois et au Morvan. De mauvaises langues
diraient que la terre est bazocienne et que les
mentalités sont morvandelles. La géologie n’est
très majoritairement pas granitique mais le socle
hercynien n’est pas loin, ni en profondeur, ni en
géographie puisque Saint Péreuse, au Nord, de
l’autre côté de la haute vallée du Morlon,
actuellement rattachée au Parc Naturel Régional du
Morvan, repose sur un chaînon occidental avancé du
Morvan. Et les ondulations plus ou moins prononcées de
terrain dans un bocage à semi-bocage très peu boisé
annoncent déjà le Morvan tout proche tout en rappelant
le Bazois - le Morvan que l’on peut voir des
hauteurs de la Chaume Gueulot ou de l’Ouche Buchon,
au-dessus de la vallée du Garat. Le style des maisons
dans un habitat profondément dispersé, rappelle
beaucoup l’architecture rurale morvandelle :
rez-de-chaussée de plein pied ou surélevé sur cave,
comble à surcroît à jours oblongs ou parfois ovales,
porte haute de comble accessible par une échelle mobile
ou un escalier généralement au pignon, dépendances et
logis le plus souvent sous le même toit ; et,
comme ailleurs, ce sont les fermes isolées dans le
bocage qui l’emportent largement sur des
agglomérations franchement constituées. |
Fief d’une baronnie très puissante se mouvant dans la châtellenie de Moulins-Engilbert, celle des Chandio (Jean de Champdeo descendait des ducs de Bretagne) jusqu'en 1590, posséssion de Jean Sallonyer jusqu'en 1700 puis des de Meun (vieille famille originaire de l'Orléanais depuis le XIIème siècle), qui régna de Chandioux jusqu’à la fin du 18ième siècle, la commune actuelle de Maux, qui est la réunification des paroisses de Maux, Chamnay et Abon, garde encore les traces de leur possessions foncières et immobilières. Un certain François Jacques-Charles Alixand, un des seigneurs de Maux (1671-1752), fut conseiller et médecin de Louis XIV en 1697. Les ruines du château de Chandioux, au Nord de Chamnay (autrefois orthographié Chamenay), de loin l’agglomération la plus importante de la commune, en sont les stigmates patent et dramatiques d’un règne déchu : elles ont été inscrites aux Monuments Historiques par arrêté du 9 janvier 1970. Un gîte rural y a été aménagé. La seigneurie de Mont-en-Genevray, plus au Sud, mouvait en partie du Roi, en partie du duché de Nevers. Pierre I de Nourry, seigneur de Nourry, Vandenesse et autres lieux, en était à l'origine le propriétaire ; il était conseiller du Duc de Bourbon et habitait surtout à Moulins-en-Bourbonnais. En 1635, La "Terre de Mont" appartenait à Jean de Chamdiou, puis passa à la famille de Bèze, branche de Lys, originaire de Vézelay. Au 18ième siècle, la seigneurie passa à plusieurs propriétaires, notamment la famille Gueneau avec Charles, avocat en Parlement, juge ordinaire de la châtellenie de Moulins-Engilbert, qui avait épousé Jeanne Martin. Le domaine appartenait à Nicolas Gobellin, marchand, losrqu'il passa à Paul-François Sallonnyer qui détenait également le fief de Chaligny, sur Saint-Péreuse. François Sallonnyer de Chaligny naquit de l'union de Paul-François avec Jeanne Pierrette Rapine de Saxy et, à la suite de son père, fut maire de Maux avant qu'il n'émigrât en 1792. Revenu au pays, François Sallonnyer de Chaligny occupa diverses fonctions administratives avant d'occuper le poste de sous-prefet à Château-Chinon jusqu'en 1831. Au début du 20ième siècle, la terre et le château de Mont-en-Genevrey à Maux appartenaient, du fait du mariage de Marie Augustine Honorine de Bèze avec Paul Alexandre Gabriel de Fontenay, à la famille de Fontenay, qui résidait également à Paris. Le château, qui est actuellement occupé par la famille Boyer de Bouillane, a depuis été bien restauré. Cette dernière famille, d'origine dauphinoise, qui a également des attaches à Saint-Péreuse, est, parmi bien d'autres, une descendante d'Hugue Capet et de Philippe le Beau. Quant à la terre de Beunas, nom d'un lieu-dit encore existant, elle a longtemps appartenu à l'abbaye de Saint Martin d'Autun via le prieuré de Commagny ; attachée à la mense de l'Abbé Jean de Marigny, elle fut donnée en 1334 à la mense conventuelle de Saint Martin avant de revenir au château actuel, datant de 1866, après avoir été une possession de Charles le Chauve : au cours des siècles, diverses donations firent de cette terre un fief important, ayant droit de haute et de basse justice. Elle appartient aujourd'hui, du moins dans ce qu'il en reste, à la famille Guillier de Chalvron, la seule branche subsistante dans la région d'une des grandes familles bourgeoises rayonnant autour de Moulins-Engilbert. Le Grand-Massé et les bois du Chapître relevaient jusqu'à la fin du 18ième siècle de la collégiale de Moulins-Engilbert. A la Révolution Française, la commune fut représentée aux Etats Généraux par Jacques Louis, Vicomte de la Ferté Meun, seigneur de Saulière, qui, en fait était le fondé de pouvoir de Jacques Marie de la Ferté Meun, seigneur en partie de Chamdiou, la dame Reine de la Ferté Meun, épouse de Guillier de Cromas, détenant l'autre partie de la seigneurie. Maux, en fait, n’est qu’un tout petit hameau près duquel il fallut bien, au 12ième siècle, construire une église : elle fut dédiée à Saint Denis. Au 15ième siècle, elle servit vraisemblablement de chapelle seigneuriale. Elle fut entièrement reconstruite vers 1885 - l'actuelle église Saint Michel avec la flèche polygonale actuelle, et le cimetière fut construit de l’autre côté de la chaussée. Au cours de ces travaux, "mille pièces à l'effigie de François Ier et des comtes de Gien et Chateauroux" furent découvertes sous le grand autel (Beaudiau, 1857). Quant au hameau paroissial, de quelques maisons tout au plus, traversé d’une route en provenance de Chamnay, il se trouve un peu au-dessus de la rivière, dans le vallon du Morlon qui prend sa source non loin de là, près de Chandioux. La Mairie ne s’y trouve point, qui a été installée dans une ancienne ferme isolée, de l’autre côté de la rivière, en remontant sur les hauteurs de l’Huis-Labour qui séparent les vallons du Morion et du Veynon. Car, rappelons-le, la commune actuelle est le résultat de la conjonction de trois paroisses, celles de Chamnay, de Maux et d'Abon, la paroisse d'Abon étant alors liée à celle de Belleveau, par le décret consulaire du 9 Fructidor An IX. Pays verdoyant de collines et de vallons, parcimonieusement boisé, déforesté depuis le 13ième siècle, actuellement pays d’élevage (bovins essentiellement vers Ursier, mais aussi, à Charmois, ovins, caprins et équidés) et de polycultures industrielles (céréales essentiellement) comme ses paires bazociennes du canton, Maux reste le pays des croix et des " fermes-châteaux ". Pays des croix, la plupart du 19ième siècle : une croix place de l’Eglise à Maux, une à l’Huis-Labour, une près de la Chaume Gueulot, une à Chamnay en direction de Maux, une entre Chamnay et Mont et une sur la route de l’Huis-Labour, à l’embranchement de la route du hameau de Beunas. Pays des fermes-châteaux, demeures bourgeoises plus ou moins anciennes : dans leur ordre séculaire croissant, rappelons le château de Chandioux, du 14ième siècle, bâti sur un plan rectangulaire, avec de fortes courtines et aux angles, des tours, dont un donjon carré, remaniée au 17ième, détruit en 1786, semble-t-il, par Jacques de la Ferté-Meun, émigré trois ans plus tard, pour la construction de son château de Saulières, plus à Est, sur la commune de Saint Péreuse, actuellement déclaré aux munuments historiques depuis le 9 janvier 1970 ; citons le château de Beunas, du 15ième siècle, qui domine joliment le Veynon et fait face aux bois vallonnés du même nom et fut reconstruit - la terre de Beunas fut donnée par Charles le Chauve à l'abbaye de Saint-Martin d'Autun ; plus en aval, au Sud, de l’autre côté de la rivière, le château d’Abon, en fait une maison de maître construite en 1865 par la famille Pelletier, sur les terres d’un ancien prieuré et ancien lieu de cure qui dépendait, suivant l’abbé Baudiau, de l'abbaye Saint Léonard de Corbigny : les bâtiments agricoles, au milieu des prés, avoisinant avec un peu d’injure l’ancienne chapelle Saint Donat construite au 13ième siècle aux sources d’eaux, paraît-il, miraculeuses - chapelle remaniée au 16ième ; il appartient actuellement à la famille Laporte, qui, sur son domaine, gère également un gîte rural. Enfin, au Sud, le château de Charmois, construit à la même époque, isolé dans le bocage et visible de loin dans la saignée du Bois du Chapître, qui appartient actuellement à un néerlandais. Une Ecole Française des Métiers du Cheval s’est installée à Chamnay avec un hypodrome près de Chandioux. Un élevage de chevaux a été développé au Mazeau, près de Chamnay. La majorité des activités tournent plus ou moins directement autour de l’agriculture. Il y a quand même deux garages au Grand Massé, sur la D978, l’axe Autun-Nevers, et un électronicien-infomaticien à l’Huis-Grivaux. La commune connaît néanmoins le plus fort taux de chômage du canton du fait d'une population agro-ouvrière relativement importante. Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, que le taux annuel moyen de variation de la population calculé entre 1990 et 1999 ait été l'un des plus négatifs du canton (exode de -1,1 % par an sur dix ans). Jusqu’en 1939, la commune était traversée du tacot qui reliait Châtillon et Tamnay à Moulins-Engilbert. Il serpentait par les bois de Beunas et, dans la moyenne vallée du Veynon, passait entre Montchamois et Abon avant de longer la route, rectiligne en cet endroit, de Moulins-Engilbert. Aux confins de la commune, il traversait la route et allait se faufiler vers Nantilly, sur la commune de Limanton, avant de reprendre la direction des châteaux du Charmois et du Pavillon, sur Moulins-Engilbert. <Page précédente> <La commune vue de satellite> <Voir les lieux-dits de Maux> <En savoir plus> |
|