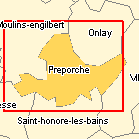Le hameau de Corcelles dans le bocage de Préporché |
A quelques encablures au Nord-Est de Saint
Honoré-les-Bains, Préporché, commune ouverte sur les
premières chaînes du Morvan, commune du Parc Naturel
Régional du Morvan depuis 1997(Décret
no 97-430 du 28 avril 1997 ), est un village
rue qui s’étend pratiquement à la source du
Donjon, ruisseau qui fait une boucle à l’Ouest de
Saint Honoré en traversant les bois des Morillons. Le bourg actuel, en lieu et place de l'ancienne Vistrae gauloise, s'étend sur la pente d'une colline le long de la D157. Comme
Villapourçon, le toponyme Préporché indique un endroit
pour l’élevage des porcs. Le nom apparaît en 1287
sous la forme Pria Procherii. Les châtaigneraies proches
du village et les châtaigniers du bocage autorisaient ce
type d’élevage qui, du reste, n’a de nos jours
jamais totalement disparu. Au nord du village, la retenue
du Boiré régule en amont les eaux du Vermoulu, ruisseau
qui conflue à l’Ouest, au hameau des Morillons, sur
la Dragne inférieure qui vient de sortir du Morvan et
s’écoule vers le Sud, vers Vandenesse. En fait, la commune recouvre
pratiquement tout le bassin-versant du Vermoulu dont fait
partie le Donjon. |
L'époque gallo-romaine a laissé des traces sur la commune de Préporché. Tout d'abord la route romaine de St Honoré à Château-Chinon par Onlay. Elle croise au Villars une autre voie est-ouest. Le long de ces deux voies, de nombreux vestiges ont été repérés : à Villars bien sûr, mais aussi à Vénitiens, à l'est, et aux Gauthés à l'ouest, à Montgaudon au sud. Dans tous ces lieux, d'importantes constructions gallo-romaines ont livré des tuiles, des amphores, des monnaies des 1ier au 3ième siècles, des céramiques, des meules à bras, des vases en bronze, ainsi que des outils en silex et des haches polies laissant présumer une occupation beaucoup plus ancienne.
Pendant longtemps, la paroisse de Préporché fut le siège des moyenne et basse justices de Genay ; leurs seigneurs en étaient les Robert d'Eschenault [de Mathieu]. Et noble Jean Baptiste Robert de Genay, époux de dame Euphrasie Moireau, fut, dans la deuxième moitié du 18ième siècle, docteur en médecine, conseiller du Roi et, au début de la Révolution, directeur du séminaire de Nevers. Au dix-neuvième siècle, une de leur fille fut l'épouse de Gustave Boucaumont, ingénieur des Ponts & Chaussées bien connu dans la Nièvre, qui fut également député, lequel laissa son nom à une place de Moulins-Engilbert qu'il conçut lui-même en 1860. A la fin du 18ième siècle, Préporché a été également le lieu de résidence d'un certain Jean Nicolas de Davoust, écuyer, annobli un certain 15 avril 1731 aux fins d'éviter la taille, qui n'était que l'oncle du maréchal du même nom, prince d'Eckmühl : celui-ci vint dans la commune prendre sa succession à la mort de cet oncle. Il avait un frère, Jean Davout, également écuyer, né à Préporché en 1735, neuvième de ce nom, qui devait mourir en ce même lieu "sans avoir pris alliance". Il y eut jusqu'à l'avant dernier siècle des communautés taisibles, forme de communautés de fait composées de familles qui, au Moyen-Âge, étaient serviles. La vie commune en était le principe fondamental - communauté de vie et de biens, communauté d'activités -, ce qui permettait "théoriquement" d'échapper à la mainmorte, droit féodal qui interdisait la transmission des biens aux survivants si ce n'est au seigneur. Ces communautés "tues" de parsonniers, une des formes sociales de l'économie agricole médiévale, émanaient directement du droit médiéval du servage alors en vigueur : les terres accordées par le seigneur ne devaient leur salut que dans la communauté. Préporché n'était pas un cas particulier puisque cette forme d'organisation sociale s'était développée un peu partout dans le Morvan pour éviter, outre la mainmorte, le morcellement des biens et le paiement des droits de ban. De cette organisation viennent souvent, entre les 14 et 16ième siècles, les toponymes commençant pas "Huis" ou par "Chez" ou encore par "Les", suivis du nom de la communauté familiale "cachée" ou "tue". Généralement, ce type de communauté disparaît à la fin du 16ième siècle avec une relative dispersion de la famille autour de la maison-mère, d'où la formation de hameaux. A Préporché, il y avait deux communautés identifiées, l'une aux Beauné avec les Leger-Courault, l'autre aux Garriaux avec les Panné, cette dernière ayant fait dès 1840 l'objet d'une étude par Maître Dupin, alors député de la Nièvre. Cette situation, à la limite de la communauté sectaire, eut l'originalité de perdurer pratiquement jusqu'au 19ième siècle avec la famille des Panné-Garreaux dont on peut encore voir la maison d'origine datant des 16ième et 17ième siècles au lieu-dit du même nom (Les Garriaux) au terme d'une petite route vagabonde, sur une petite butte entouré d'un ravin qui en rend l'accès assez difficile. Victor Considérant et Victor Meunier, dans leur ouvrage " Le socialisme devant le vieux monde, ou Le vivant devant les morts", publié en 1849, rapportent dans une lettre de Maître Dupin que le dernier maître emporta chez lui, "comme un trophée, le grand pot de la Communauté", n'ayant vu dans la misère constatée de celle-ci que la mauvaise gestion, en opposition totale avec la communauté nivernaise des Jault, sur la commune de Saint Benin-des-Bois, canton de Saint Saulge, prospère et bien entretenue, datant vraisemblablement d'avant 1500, et qui, malgré plusieurs tentatives de dissolution, perdura bien après la Révolution sous la forme d'une Association de Travail. A l’extrémité Ouest de la commune, au dessus de la Dragne (souvent dénommée ici Vandenesse) et du Vermoulu, le domaine des Morillons, d'environ 90 ha, a été créé en 1701 par la communauté religieuse de Picpus, établie à Moulins-Engilbert dès 1630 suivant les voeux de Gabriel Reullon. Ce domaine comprenait la bâtisse des moines et la chapelle, une ferme-écurie, une maison de vigneron, une maison de gardien et une ferme. On y cultivait de la vigne, à la proximité de laquelle passait la chaussée romaine. Et, à Morillon même, il y avait une maison seigneuriale. A Préporché, l’église paroissiale
Saint Pierre, propriété de la commune, au portail de
style roman, a été construite, sans qu’on en soit
fort sûr, au 12ième siècle. Elle fut
incendiée en 1570 par les huguenots (nom donné aux protestants par les catholiques pendant les guerres de religion). Le patronage de la cure appartenait au 17ième siècle aux Picpus de Moulins-Engilbert et les dîmes étaient partagés entre ces religieux, le curé, le seigneur de Villars et celui de la Montagne. L’antique
façade romane a été détruite et reconstruite en 1872
au cours de travaux de restauration et, en 1920, la
chapelle gauche fut ajoutée. L’église, dont le clocher est surmonté d'un toit à deux pans, abrite
actuellement une statue de Saint Pierre en bois
polychrome datant du 16ième siècle. Elle a
été récemment restaurée et les vitraux,
contemporains, date de sa dernière restauration. Près de l’église, une ferme du 19ième siècle, avec grange et cour, rappelle le style morvandeau de toutes les fermes et fermettes du siècle dernier avec un toit à longs pans couvert d’ardoises, un escalier droit menant à l’entrée et un escalier extérieur menant aux combles. Sur la commune, une trentaine de maisons sur les 210 cadastrées reprennent, à quelques variantes près, la même norme d’architecture. A quelques centaines de mètres au Nord, à l’écart du village paroissial, au lieu-dit des Places, s’y trouvait une ancienne Maison Forte qui a été détruite et les pierres reprises pour y construire en lieu et place, en 1846, une Maison d’Ecoles, tenue par des religieuses. En allant
sur Moulins-Engilbert, soit au Nord-Ouest, à
l’orée de la commune, se trouve le château de
Montjoux, du nom du hameau qui se trouve à quelques
centaines de mètres de là : Montjoux était une ancienne maison forte, attestée au 14ième siècle, construite au sommet d'une butte naturelle. Elle est aujourd'hui ruinée. Une ferme en occupe l'emplacement. Le nouveau château a été bâti un peu plus bas. C'est
un beau corps de logis
du 18ième siècle, construit de calcaire,
granit et grès, remanié au 19ième, avec un étage et un
étage de surcroît, un toit à long pan couvert de
tuiles plates, des communs et un jardin à
l’anglaise ; une chapelle y a été construite un
siècle plus tard. Une allée forestière privée,
barrée à chaque entrée d’une somptueuse grille, y
amène en le contournant par l’Ouest avant de
remonter par les bois de l’Alliot vers le moulin des
Verdelles et le hameau de Dragne, sur la rivière du
même nom. En 1519, Claude Lebault, seigneur de Monjoux, épouse Marie de Champ. Puis le domaine tombe en possession de Guillaume de Grandry, également seigneur de la Montagne : il se marie deux fois, avec Marie Bataille, puis avec Jacquette Aubry qui achète le domaine à la mort de son époux. Au début du 18ième siècle, le domaine passe à la famille Alloury. En 1714, le fief est adjugé à Charlotte Duruisseau (1666 - 1726), veuve de Guillaume Alloury (1656 - ?), lequel fut procureur du Roi à Moulins-Engilbert. Précisons que la famille Duruisseau joua un rôle politique important par Pierre Duruisseau (1650 - ?), notaire royal, qui, marié avec Ursule Alloury (1658 - ?), soeur de Guillaume, fut longtemps maire de Moulins-Engilbert, au 17ième siècle. Pendant longtemps, le domaine et le château furent une possession des Alloury, branche d'Avallon, et des Sallonnyer. La Pierre Cautin, isolée, près des bois de la Corvée, serait tombée, suivant une légende en cours dans le Morvan, du tablier des Fées. Des traces d’un pont romain auraient été décelées sur la Vandenesse, au lieu de passage de la chaussée romaine. Commune
essentiellement bocagère, l'une des premières du canton à avoir fait l'objet du remembrement (dans les années soixante essentiellement), commune au relief mamelonné et
entrecoupé de cours d’eau permanents comme la
Vandenesse (ou Dragne), le Vermoulu, le Donjon, et un
nombre important d’intermittents, elle est bordée
sur sa limite orientale du Mont Genièvre qui, derrière
Vénitiens et le Crot du Loup, en est le point le plus
élevé (637 m) - la limite occidentale étant
essentiellement constitué des collines argilo-calcaires
en bordure de la Dragne. Les bois de l’Alliot, de
Morillon et ceux du Mont Genièvre sont pratiquement les
trois seuls massifs forestiers périphériques dignes de
ce nom de la commune. Inutile de dire que
l’activité dominante est l’élevage bovin et
porçin, auquel s’ajoute çà et là des cultures
fouragères et industrielles. <Page précédente> <La commune vue de satellite> <Voir les lieux-dits de Préporché> <En savoir plus> |
|